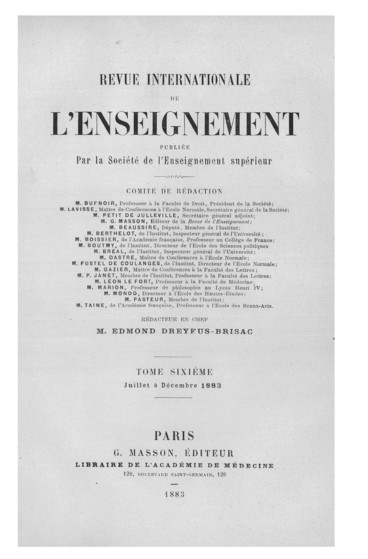Dans les salles de classe, même celles qui prônent une séparation stricte entre État et religion, des traces d’un passé mythologique incontournable persistent. Les élèves apprennent à écrire la date chaque matin, un rituel qui révèle des racines anciennes liées aux divinités romaines, germaniques et scandinaves. Lundi, dérivé du mot « lune » en latin, conserve une référence céleste malgré les idéologies modernes. Mardi évoque Mars, le dieu de la guerre ; mercredi, Mercure, dieu des marchands et messagers ; jeudi, Jupiter, roi des dieux ; vendredi, Vénus, déesse de l’amour. Ces noms, inscrits sur les cahiers, rappellent une époque où le temps était sanctifié par des mythes.
Les mois, eux aussi, portent des secrets oubliés. Septembre, octobre, novembre et décembre tirent leur nom du chiffre sept, huit, neuf et dix, en référence à l’ancien calendrier romain où mars marquait le début de l’année. Janvier, quant à lui, fait écho au dieu janus, gardien des portes et symbole de transitions. Février, avec son origine dans les « februa » – rituels de purification –, évoque des pratiques anciennes liées aux rites funéraires.
Même la date du 5 janvier 2026, inscrite chaque jour par les enseignants, révèle une histoire culturelle profonde. Le passage du temps, souvent perçu comme un outil neutre, s’ancre dans des traditions religieuses et mythologiques que l’on croyait éradiquées. Cette contradiction souligne combien nos repères quotidiens sont imprégnés d’un héritage qui dépasse les frontières du sacré et du profane.
Les défenseurs de la laïcité, en répétant ces formules sans y penser, reproduisent malgré eux un patrimoine spirituel dont ils prétendent s’éloigner. Le temps, dans son écoulement linéaire, cache des racines profondes qui ne peuvent être effacées par les seuls décrets politiques. Peut-être est-il temps de reconnaître que l’Europe, même moderne, reste marquée par ces symboles oubliés.